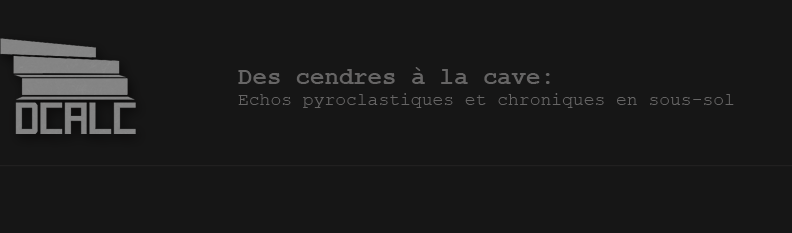Comment faudra-t-il s'y prendre pour transmettre une émotion ? Quoi de plus idiosyncrasique et subjectif qu'une impression ? Comment expliquer en quoi un amalgame de bruits bruts - guitares concassées, voix littéralement expulsées dans un râle qui tient autant de la souffrance que de la délivrance, production réduite au strict minimum (
Jack Shirley au mixage, déjà croisé aux côtés de
Wreck & Reference) permettant néanmoins d'encore percevoir quelque chose, boîte à rythmes de guingois et hoquetante, samples puisés ici mais encore plus sûrement là-bas, particules électroniques hérissées et contondantes - peut-il produire tant de remous sur/sous l'épiderme et tout autour ? D'autant plus que ce nouvel album de
Mamaleek ne paie pas de mine de prime abord. Tout comme les précédents. Rien de nouveau. Du black canal historique muni d'atours incongrus qui le sortent de sa niche et le précipitent dans l'avant-garde. Attention, rien d'abscons non plus. Simplement un télescopage, inattendu certes mais exploré depuis déjà trois albums. Et ce n'est pas
He Never Spoke A Mumblin' Word qui viendra rompre le paradigme. Enfin, pas complètement en tout cas. On reconnaît bien l'art des deux frères anonymes qui n'enregistrent plus dans leur chambre toutefois. Si l'un est toujours à San Francisco, l'autre semble s'être délocalisé à Beyrouth. Sans doute tient-on d'ailleurs là l'une des forces motrices de ce nouvel album qui, non content d'orchestrer la collision d'étiquettes aussi éloignées que le black metal (étiquette qu'ils réfutent d'ailleurs) et l'électronique dans son versant harsh noise, manipule également la tectonique des plaques et précipite le Moyen-Orient dans l'Amérique et réciproquement. Tout cela définit
Mamaleek. C'est peu mais comme il sera difficile d'en savoir plus - un brin introvertis, ces deux-là volent en permanence sous les radars - c'est sans doute déjà bien assez. Pour le reste, on ne peut qu'ausculter leur musique et cette fois-ci, le duo a rallongé le temps tout en resserrant le propos. Un léger paradoxe qui confère à
He Never Spoke A Mumblin' Word un côté franchement monolithique bien que toujours varié.
Quatrième album présenté comme une fin autant qu'un commencement. Quatre morceaux arborant toujours le même côté bestial et approximatif. Quatre morceaux portés par des voix étranglées, agressives et une boîte à rythmes qui marque par sa simplicité. Toujours ce maelstrom de guitares torturées au grain surexposé qui campent des arabesques étranges et déformées. On comprend très vite en quoi
He Never Spoke A Mumblin' Word peut représenter une fin puisqu'il synthétise l'essence de
Mamaleek, son ADN tout entier contenu dans ces quatre titres : le côté crade et compressé (
Almost Done Toiling Here, un paroxysme), les textures et emprunts venus d'un ailleurs très bien documenté (l'introduction de
Poor Mourner's Got A Home, les chœurs lointains de
My Ship Is On The Ocean), l'électronique qui rigidifie l'organique et l'organique qui déborde en permanence l'électronique, l'amalgame des deux sculptant un black singulier, tout à la fois engoncé dans des limites exsangues - celles imposées par des morceaux à qui il faut bien donner un début et une fin - et débordant, étant donné le caractère flou et indéfini de ces dernières. En permanence sur le fil,
Mamaleek se tient exactement sur la frontière entre palpable et impalpable, entre clarté et absence de clarté, risquant en permanence de verser dans la bouillie sonore absolument vaine sans pour autant y tomber le moins du monde. Jamais. Parce que
Mamaleek a une vision, un truc chevillé aux tripes qui ne demande qu'à sortir. Un poil ésotérique mais bel et bien là : "
There is a life inside me and its need for escape is dogmatic and incorrigible" prévient-il d'ailleurs fort justement. Un commencement aussi parce que
He Never Spoke A Mumblin' Word, en limitant le nombre de morceau, garde une unité, certes déjà présente sur les opus précédents, mais ici parfaitement dosée. On retrouve toujours les changements de directions iconoclastes, les accents incongrus qui éloignent le duo de la stricte sphère black - poussières shoegaze, agrégats ethno-décalés, électronique pure, breakbeats extrêmement fugaces (bien plus que sur l'opus précédent) - mais cette fois-ci au sein des morceaux et non plus seulement de l'un à l'autre.
On commence d'ailleurs par l'éponyme qui reprend les choses là où
Kurdaitcha (2011) les avait plus ou moins laissées : toujours cette agression sombre, en négatif et légèrement abstraite avec chœurs célestes en contrepoint du growl déchiré. Le grain des guitares se fait plus massif, la production plus ample même si elle conserve son côté brouillon. Un peu comme si
Mamaleek avait poussé tous ses traits à l'extrême limite : encore plus sauvage et mal peigné, encore plus noir, encore plus disloqué. Une entame et un épilogue apaisés venant circonscrire un morceau pour le moins arraché. Ça avance, ça ralentit et ça s'évapore dans un souffle pour laisser la place à une psalmodie orientale qui annonce le début du très ténu
Poor Mourner's Got A Home. Dix minutes de nappes synthétiques enveloppantes s'opposant à la sauvagerie définitive de la voix. Il n'y a bien que la boîte à rythmes - pourtant à l'agonie - qui tienne un peu debout, résistant aux multiples pains que lui assène la guitare. Pour le reste, le morceau fait penser à une implosion et se recroqueville sur lui-même. Patraque, ondes basses en avant, il dessine des arabesques abstraites souvent belles dont le voile fragile est impitoyablement lacéré par la voix possédée. On est alors prêt pour les lignes de crêtes, les stigmates compressés et l'agression par arme blanche de
Almost Done Toiling Here. Parfait amalgame électro-metal, on tient sans doute là le
Mamaleek prototypique : son dégueulasse, ondes maléfiques bien plus que riffs charpentés, nappes solennelles, tempo monomaniaque au bout du bout du rouleau, on attend juste que le morceau, le disque et le groupe s'échouent à nos pieds puis s'enfoncent dans la terre.
My Ship Is On The Ocean est du même bois lugubre puis laisse doucement la place à une mélopée tout autant mantra que rite funéraire, venant définitivement clore l'ensemble. Quelque chose comme une parfaite mise en bière.
Ni complètement doom, ni complètement black, encore moins noise, shoegaze ou purement électronique,
He Never Spoke A Mumblin' Word est tout cela à la fois et en saupoudrant sa mixture malsaine de pincées de folklore traditionnel,
Mamaleek commet un album qui tient effectivement du commencement. Sans doute plus assuré, plus exacerbé, on voit bien qu'il est difficile d'expliquer en quoi un édifice si imparfait sonne si parfaitement. Une alchimie inexplicable qui touche tout aussi inexplicablement. En profondeur. Un disque qui charrie une espèce de sang industriel dont la force tellurique frappe la plante des pieds. Pourtant, une nouvelle fois, tout cela ne paie pas de mine. L'essentiel est ailleurs. Pas seulement dans la musique mais aussi en nous et dans ce qu'elle provoque. Mais l'on sait évidemment que le mieux est encore de se taire et de la laisser s'élever et envelopper l'espace pour le remodeler. Dont acte.
Remarquable.
leoluce