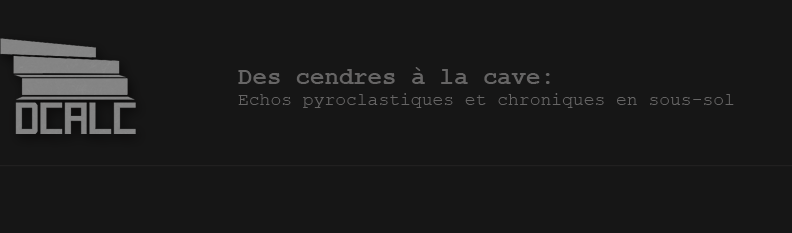Date de sortie : 31 janvier 2013 | Label : Zeitgeists Publishing
Extrêmement mystérieux, Architeuthis Rex. Tout comme sa musique. On ne sait vraiment pas grand chose de ce duo italien, si ce n'est qu'il semble s'agir là de son quatrième long format après trois autres parus initialement sur Utech (et disponibles sur leur page Bandcamp). On sait également qu'il compte dans ses rangs une certaine Francesca Marongiu, déjà évoquée dans ces pages à la faveur de son projet Agarttha. Elle est ici associée à Antonio Gallucci et tous les deux dessinent les contours d'une musique opalescente et floue, habitée et prenante, lorgnant tout à la fois du côté du drone et du post-punk. Et encore, il s'agit là de deux balises qui tentent de cerner à grand-peine le chemin vraiment indéfini emprunté par le duo. Évoquant quelque chose comme les Cocteau Twins possédés par les démons de la kosmische musik, on y trouve également des accents dub assez marqués ainsi que des nappes synthétiques qui débordent l'ossature des morceaux et des percussions tribales qui les y ramènent inéluctablement. Architeuthis Rex privilégie l'implosion et la lenteur, prend le temps d'installer ses ambiances, y déploie ses textures variées et tresse des pièces écorchées dont il est bien difficile de se défaire. Mettant tantôt ses guitares en avant (Eleusis), tantôt ses claviers (Demeter Lousia), le duo, quoi qu'il fasse, enveloppe. Ce qui relève de la gageure lorsque l'on met en avant une telle économie. De prime abord, la musique d'Architeuthis Rex semble recouverte d'un vernis ésotérique qui confère à l'ensemble son côté mystérieux. On a alors vraiment l'impression d'avoir entre les oreilles un document sonore qui ne nous est en aucun cas destiné. Que le duo joue avant tout pour lui-même bien plus que pour les autres. Mais passées les premières écoutes, il devient évident que l'on à affaire ici à quelque chose de mûrement réfléchi et de très détaillé qui n'a d'autre but que de capturer les auditeurs égarés. Pomegranates, par exemple, met d'abord en avant ses percussions mêlant boîte à rythme et batterie puis passe le plus clair des sept minutes restantes à les noyer sous un entrelacs de claviers (orgues Hammond et Farfisa, synthétiseur) et de guitares saturées. Un amoncellement d'où naît pourtant une mélodie qui apparaît comme si de rien n'était, provoquant une transe ouatée dès lors qu'on ne s'occupe plus que de suivre les circonvolutions des nappes qui se montent les unes sur les autres. C'est vraiment la marque de fabrique du duo, cette propension à capturer l'attention et à la diriger complètement et uniquement vers sa musique.
Eleusis en référence aux mystères du même nom. Un culte en principe secret célébré dans le temple de Déméter au coeur de la ville d'Éleusis. Lesdits mystères s'appuient sur l'histoire de la déesse Déméter dont la fille, Perséphone (appelée Coré dans sa prime jeunesse), fut enlevée par Hadès. Déméter entreprend un voyage de 9 jours et 9 nuits à la recherche de celle-ci et, se faisant, entre dans la cité d'Éleusis sous les traits d'une vieille mendiante. Elle fait l'objet d'une telle hospitalité que la déesse, reconnaissante, dévoile sa véritable identité, partage ses mystères et offre aux citoyens la maîtrise de l’agriculture. Traditionnellement interprété comme une figure du changement des saisons, on comprend très vite pourquoi Architeuthis Rex a choisi ce titre. On chemine d'une face à l'autre comme cheminent les saisons. Tour à tour glacial et chaud, d'humeur sans cesse changeante, l'album varie ses approches et ses textures bien que sa construction soit parfaitement symétrique : en ouverture de la face A, Hades, congelé et éthéré, rejoint ainsi Ladon qui, lui, ouvre la face B. Ce sont les deux morceaux les plus courts, les plus froids. Un vent d'hiver parcourt alors la musique. Plus loin, Eleusis, vraiment magnifique, répond à Pomegranates et ces deux-là sont, quant à eux, plutôt solaires. Sans doute est-ce dû à leurs claviers majestueux qui offrent un contrepoint lumineux aux guitares vraiment sales et saturées. Enfin, Demeter Lousia et Triple Goddess flinguent les degrés et rabaissent sérieusement la température sans atteindre toutefois le zéro absolu d'un Hades ou d'un Ladon. Alors, difficile de savoir si le concept a précédé l'édification des morceaux mais quoi qu'il en soit, le message se superpose parfaitement à la musique sans qu'aucun des deux ne prenne l'ascendant sur l'autre. On est ainsi face à une œuvre globale qui s'écoute tout autant qu'elle se comprend sans être le moins du monde hermétique. Bref, quelque chose d'intelligent, de subtil qui s'insinue à son rythme. Les premières écoutes m'ont ainsi laissé de marbre. En revanche, les atours intrigants et indéfinis d'Eleusis m'y ont régulièrement ramené. Peut-être l'envie de percer le mystère ? De circonscrire un disque qui met en avant, crânement, la part d'impalpable que renferment ses morceaux ? Qu'importe, ce qui est sûr, c'est que depuis il ne s'est jamais trouvé bien loin des têtes de lecture et qu'il résonne régulièrement lorsque le quotidien se montre aliénant, mettant en avant tout le pragmatisme nécessaire à son cheminement. Dans ces moments-là, écouter Architeuthis Rex, c'est la promesse d'un bon uppercut dans le ventre mou du temps qui passe, d'un gros coup de gomme sur les bordures de l'emploi du temps.
Avec ses percussions chiches, ses guitares plombées et ses nappes habitées, le duo met sur pied une musique dense et délicate qui frappe avant tout par sa beauté.
Eleusis en référence aux mystères du même nom. Un culte en principe secret célébré dans le temple de Déméter au coeur de la ville d'Éleusis. Lesdits mystères s'appuient sur l'histoire de la déesse Déméter dont la fille, Perséphone (appelée Coré dans sa prime jeunesse), fut enlevée par Hadès. Déméter entreprend un voyage de 9 jours et 9 nuits à la recherche de celle-ci et, se faisant, entre dans la cité d'Éleusis sous les traits d'une vieille mendiante. Elle fait l'objet d'une telle hospitalité que la déesse, reconnaissante, dévoile sa véritable identité, partage ses mystères et offre aux citoyens la maîtrise de l’agriculture. Traditionnellement interprété comme une figure du changement des saisons, on comprend très vite pourquoi Architeuthis Rex a choisi ce titre. On chemine d'une face à l'autre comme cheminent les saisons. Tour à tour glacial et chaud, d'humeur sans cesse changeante, l'album varie ses approches et ses textures bien que sa construction soit parfaitement symétrique : en ouverture de la face A, Hades, congelé et éthéré, rejoint ainsi Ladon qui, lui, ouvre la face B. Ce sont les deux morceaux les plus courts, les plus froids. Un vent d'hiver parcourt alors la musique. Plus loin, Eleusis, vraiment magnifique, répond à Pomegranates et ces deux-là sont, quant à eux, plutôt solaires. Sans doute est-ce dû à leurs claviers majestueux qui offrent un contrepoint lumineux aux guitares vraiment sales et saturées. Enfin, Demeter Lousia et Triple Goddess flinguent les degrés et rabaissent sérieusement la température sans atteindre toutefois le zéro absolu d'un Hades ou d'un Ladon. Alors, difficile de savoir si le concept a précédé l'édification des morceaux mais quoi qu'il en soit, le message se superpose parfaitement à la musique sans qu'aucun des deux ne prenne l'ascendant sur l'autre. On est ainsi face à une œuvre globale qui s'écoute tout autant qu'elle se comprend sans être le moins du monde hermétique. Bref, quelque chose d'intelligent, de subtil qui s'insinue à son rythme. Les premières écoutes m'ont ainsi laissé de marbre. En revanche, les atours intrigants et indéfinis d'Eleusis m'y ont régulièrement ramené. Peut-être l'envie de percer le mystère ? De circonscrire un disque qui met en avant, crânement, la part d'impalpable que renferment ses morceaux ? Qu'importe, ce qui est sûr, c'est que depuis il ne s'est jamais trouvé bien loin des têtes de lecture et qu'il résonne régulièrement lorsque le quotidien se montre aliénant, mettant en avant tout le pragmatisme nécessaire à son cheminement. Dans ces moments-là, écouter Architeuthis Rex, c'est la promesse d'un bon uppercut dans le ventre mou du temps qui passe, d'un gros coup de gomme sur les bordures de l'emploi du temps.
Avec ses percussions chiches, ses guitares plombées et ses nappes habitées, le duo met sur pied une musique dense et délicate qui frappe avant tout par sa beauté.
leoluce