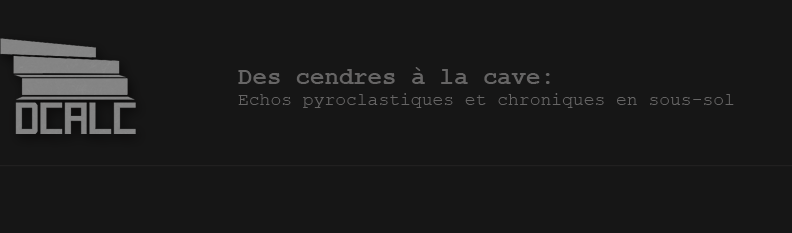Date de sortie : 03 avril 2013 | Label : Hymen Records
Déjà, en soi, le « concept » à l’œuvre derrière
cette musique interpelle : une collaboration entre un musicien et
lui-même. Dans le temps. Entre lui aujourd’hui et lui enfant, lui à peine sorti
de l’adolescence et lui maintenant. Et emprunts à tout ce qu’il a pu piocher à
ces différentes époques, lui permettant d’avoir été ce qu’il fut et de devenir
ce qu’il est. Pêle-mêle : vieux sons de synthétiseurs analogiques inspirés
des dessins animés et documentaires animaliers circa ‘70s et ‘80s, éléments psytrance,
électronica et électrodub, déconstruction et expérimentation. Le tout amalgamé, échantillonné, déstructuré,
fragmenté et recomposé au travers du prisme des technologies
d’aujourd’hui. Et de son savoir faire patiemment construit au fil du
temps. Un genre de mise en abyme qui donne le tournis. Et qui fonctionne. Le
disque n’est pas rattaché à une époque au détriment des autres, il ne sonne ni
actuel, ni daté. Il sonne. Simplement. On reconnaît bien de-ci de-là des
boucles de synthétiseurs qui résonnent avec des souvenirs d’enfance, des beats
qui débarquent de recoins reculés du cortex que l’on avait fini par oublier et
pourtant, cela ne fait naître aucune nostalgie. Le moteur se situe
effectivement ailleurs. Une partie des sons fondateurs de l’esthétique à l’œuvre
mais aussi d’autres plus frondeurs se retrouvent d’ailleurs
dans le long mix réalisé spécialement pour la sortie de
Retrofuture. Pas d’extraits de l’album
ici (enfin, si, trois pour être précis et tous magnifiques) mais plutôt une
présentation de tout ce qui a pu l’inspirer, ce qui est assez bien vu car à
l’issue de l’écoute, même sans avoir entendu les moindres boucles ou motifs de
Druc Drac, vous saurez exactement de quoi il retourne puisque tout cela se retrouve dans sa musique. Cette dernière n'est toutefois en rien un pompage éhonté, pas plus qu'un hommage ému : sa personnalité est bien trop forte pour tomber dans ce genre de travers. Le disque sortira
aussi précisément le 03 avril, date de l’anniversaire de
François de Roubaix, grande
influence du disque. Une preuve supplémentaire que cette musique ne laisse rien au hasard. Et pourtant, si on sent très bien la réflexion qui la soutient, elle n'en reste pas moins joliment instinctive et spontanée.
Mais d’ailleurs, niveau musique, de quoi peut-il bien
s’agir ? C’est un disque à la fois froid et chaleureux. Un manteau de
neige d’un blanc immaculé qui recouvre un tapis basaltique de lave refroidie.
Très aéré, extrêmement texturé, on accroche rapidement à la dentelle
électronique qui concourt à la naissance de belles mélodies. À bien y regarder,
les morceaux sont assez hachurés mais cela ne se fait jamais avec
brutalité : une nappe abstraite rejointe par un vrombissement synthétique
digne du Plastikman des débuts, des claviers cheap débarquant tout droit des premiers dessins animés japonais qui inondaient à l'époque les ondes hertziennes d'Antenne 2
confrontés à un soubassement bourdonnant plus actuel et ainsi de suite. De la même façon, chaque titre se présente comme un échantillon des influences de Druc
Drac, il est aussi une suite d’échantillons de morceaux qui auraient pu, tout
seuls, être complètement différents mais qui se retrouvent amalgamés dans une
sorte de synthèse extrêmement bien pensée et d’une belle délicatesse. L’édifice
laisse croire d’ailleurs à une grande fragilité, une sorte de château de cartes
que le moindre courant d’air pourrait emporter ou une cathédrale en cristal
très travaillée que le plus petit choc pourrait faire s’écrouler mais pour peu
que l’on détaille l’architecture, on se rend bien compte que les fondations
sont plutôt du genre solides. Le disque semble cultiver les
contradictions : de prime abord, un joli papier peint sonore qui cache
pourtant un parterre expérimental assez maousse ou des mélodies accrocheuses
qui ne passeront pas l’hiver mais qui pourtant s’accrochent à la matière grise
pour ne plus la quitter. Le vent synthétique très léger qui ouvre le disque est
vite rejoint par des nappes plus sombres et pose d’emblée le décor : tout
sera agréable mais rien ne sera simple. Ce n’est pas une sorte de recherche du temps
perdu, aucune nostalgie ne se fait entendre, mais bien une collaboration entre un musicien et lui-même : on
retrouve l’évidence de l’enfance mais aussi les chemins plus tortueux et
impétueux de l’adolescence ainsi que les sempiternelles remises en question qui
semblent bien définir l’âge adulte.
En suivant François Dumeaux sur le chemin qui relie Druc
Drac à son enfance, on se surprend à tracer une ligne parallèle qui ressemble,
et c’est assez déstabilisant, à la sienne. Comme s’il avait mis le doigt sur
une sorte de déterminisme, comme si ses influences étaient aussi les nôtres,
comme si nous étions lui et que, lui, était nous. On s’approprie son
exploration, on la fait devenir sienne alors que lui se met à nu et dévoile son âme. Ce qui
donne une sacrée densité à sa musique qui nous embrigade et qui résonne
d'accents immédiatement familiers alors même qu’on la découvre. C’est un mouvement d’ailleurs assez
inédit : habituellement, c’est en réécoutant un disque que l’on s’habitue à
lui et que l’on finit par cerner ses moindres détails. Là, il s’agit du
mouvement inverse : d’emblée, on à l’impression de très bien le connaître alors que toutes les écoutes suivantes nous éloignent de la connivence
que l’on semblait partager avec lui. C'est qu'il faut, l'air de rien, un certain temps pour commencer à comprendre ce qui peut bien faire le charme de krysmopompas, galop synthétique que rien n'arrête à la météo cabossée, tantôt orageux lorsqu'il court le 100 mètres, tantôt ciel de traîne lorsqu'il développe des boucles aérées. Même chose du côté de téléfax qui le suit immédiatement et qui arpente, lui, la voie de l'apaisement. Plus loin, anuèit se construit par accumulation de petites touches successives sur la répétition qui le porte, des boucles biscornues à l'entame, un gazouillis électronique qui les rejoint comme des insectes numériques affolés se déplaçant sur l'ossature synthétique, puis du silence, le tout dessinant un relief mouvant sur plus de sept minutes. Le disque alterne ainsi entre morceaux longs et petits interludes de moins de deux minutes qui aèrent, si besoin était, son architecture déjà en soi bien ventilée. Pour ma part, j'avoue un faible pour lysergone, petit bréviaire (pour moi, hein, peut-être pas pour vous) qui reprend un peu tout ce que j'aime concernant les musiques électroniques.
Premier long format sous l'alias de
Druc Drac, premier coup de maître. Il faut dire que
François Dumeaux n'est pas n'importe qui et ne débarque pas de nulle part. On avait déjà beaucoup aimé
Urbatectures en 2011 en compagnie de
Nebulo qui accompagnait idéalement la lecture de
La Fièvre d'Urbicande de Schuiten & Peeters (une vraie gageure pour qui connaît la BD), beaucoup apprécié aussi sa version du
Redkosh de
Nebulo qui lui a d'ailleurs fait gagner (ex-aequo avec
Vndl) le concours de remixes organisé par ce dernier (Hymen propose d'ailleurs ces jours-ci
un EP gratuit comprenant le
Redkosh original mais aussi cinq de ses déclinaisons issues de ce concours, dont celles de
Druc Drac,
Vndl,
Shape2,
Sonic Area et
Syndrôm). Bref, on suivait
Druc Drac de loin, toujours quelque part dans notre empan auditif. Et à l'écoute de
Retrofuture, on comprend pourquoi. De la maîtrise, beaucoup, et des idées, énormément.
Inventif, appuyé, constant, varié.
Magnifique.
L'air de rien. Toujours l'air de rien. C'est bien ce qui impressionne.
leoluce