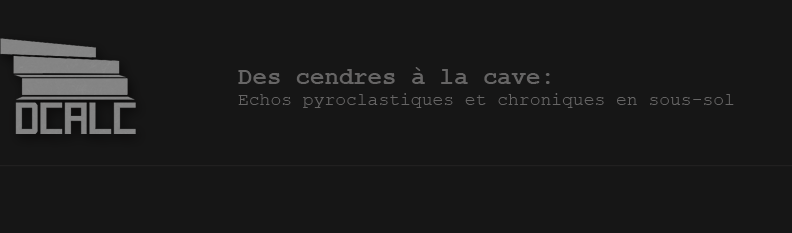Date de sortie : 3 janvier 2012 | Label : Sub Rosa
Deux titres de quinze minutes chacun, un titre de vingt. Des chœurs
élégiaques et habités, mystiques même, des nappes aiguës, parasitées, d’autres
profondes, des frottements indéterminés qui rappellent de loin l’orage
qui gronde, des notes parcimonieuses et ténues qui déroulent une mélodie
bien évidemment contemplative étant donné l’extrême lenteur de
l’ensemble et puis cette voix étouffée, trafiquée et menaçante. Ces
moments paroxystiques où tous les bruits se confrontent et ceux où au
contraire ne subsistent que les cordes d’une guitare ou le filet d’une
voix dans une dynamique absolument imprévisible. Comme si rien n’était
construit et dans le même temps, tout était écrit : difficile de ne pas
voir une part d’improvisation là-dedans. Pourtant, il faut bien avouer
que la dynamique des morceaux est tellement juste, tombe tellement bien,
qu’elle ne peut-être que le fruit d’une réflexion importante. Bref, Poisoned Soil,
c’est un petit peu tout et son contraire. À la fois extrêmement aride –
absolument rien là-dedans ne permettra à l’auditeur de trouver ses
marques et rien ne le caressera dans le sens du poil – et luxuriant – on
y trouve une telle profusion de détails qu’il y a de quoi explorer
longtemps. On a l’impression d’avoir déjà entendu cela mille fois mais,
on en est absolument certain, jamais de cette façon-là.
Comme bien souvent avec la musique drone, les repères s’effacent.
Quand le morceau a-t-il débuté ? Il y a une minute ? Quinze plutôt ? Ce
que l’on sait, c’est que tout cela passe extrêmement vite et que les
multiples changements de direction font que ne s’y ennuie jamais. Un bon
milliard d’idées au creux de chaque pièce, des directions tout aussi
nombreuses. Mais dans la cohérence. On ne peut pas confondre un titre
avec un autre et dans le même temps, on ne sait pas quand on passe de
l’un à l’autre. On y entend des bouts de Master Musicians Of Bukkake dans la mystique, des poussières d’Isis dans la dynamique, des fragments de Sunn O)))
dans l'intensité, voire du Earth et du Failing Lights dans la lenteur fureteuse et même des chants grégoriens, le tout avec ce spleen superbe,
communicatif et paradoxalement très accueillant. On pourra toujours dire
que cette musique est avant tout cérébrale, abstraite et minutieuse, que son côté caillou pelé ne parlera à personne en dehors de ceux qui en sont à l'origine, mais non, aucun risque de ce
côté-là : oui, effectivement cette musique est cérébrale mais aussi, et
avant tout, instinctive et sauvage ! Comme si l’animal qui sommeille en
nous était analysé pour mieux le faire hurler… C’est assez curieux, ce
mélange des genres, cet effacement consciencieux des frontières : les
tripes dans la tête, les neurones dans le ventre. Cette impression enfin
d’une bande-son primitive extrêmement pensée. À ce petit jeu-là, Aaron Turner n’est pas le plus malhabile, son disque est même une réussite totale.
Accompagné de sa compagne, Faith Coloccia (plus connue pour son projet Mamiffer) et de B.R.A.D. (Asva, Burning Witch ou encore Master Musicians Of Bukkake,
tiens, tiens !) aux percussions, le trio avance à l’instinct et délivre
une musique minérale jouée près de l’os. On y trouve des moments très
cinématographiques, comme les premières secondes d’Inappropiate Body
par exemple et son fourmillement de cordes, comme si le titre racontait
les aventures d’un insecte se baladant sur les os d’un cadavre, ce
genre. Car oui, les pensées sont plutôt noires, l’atmosphère loin d’être
solaire, elle fait plutôt écho à ce qu’il se passe sous terre, à ce que
l’on ne voit pas mais que l’on devine, elle suinte l’inquiétude, la paranoïa, l'angoisse et tout un tas d'autres sentiments malaisés mais n'est pas pour autant destinée qu'aux dépressifs de tout poil. Comme on peut aussi être happé par un film de Murnau
sans avoir la moindre envie de se complaire dans ses idées noires mais
parce que la force des images nous touche simplement. C’est un peu ce
qu’il se passe ici : les chœurs presque liturgiques de House Of Low Culture
restent saisissants et nul n’est besoin d’être porté sur la musique
médiévale ou les chants grégoriens pour pouvoir les apprécier, les
changements de directions multiples font sens alors qu’on peut aussi
aimer les constructions plus classiques. Le disque n’est pas destiné
qu’aux initiés qui seraient les seuls susceptibles de « comprendre ».
D’abord, parce qu’il n’y a sans doute rien à comprendre et ensuite parce
qu’avec un peu de curiosité, on peut très bien s’accaparer Poisoned Soil, les ambiances qu’il offre étant suffisamment magnétiques pour que chacun y trouve son compte.
Bien évidemment, cette musique-là est à mille lieues de celle d’Isis. Beaucoup moins massive ou arrachée, bien plus attachée aux silences, on y retrouve toutefois en creux la même architecture, le calme qui précède
la tempête mais avec une dynamique étirée jusqu’à l’extrême limite, un
mille-feuille d’émotions pourvues par ces bandes trafiquées, la nature
en arrière-plan, la roche sous-jacente. Et sans une once de gras. On y
trouvera certainement quelques longueurs aussi mais dans le même temps,
l’ensemble est à tel point sincère et cohérent que ces petites réserves
s’effacent vite devant sa majesté. Depuis ses débuts en 2000 avec Submarine Immersion Techniques Vol. 1, l’entité House Of Low Culture
n’a cessé d’évoluer au gré des rencontres et des participants,
enrichissant petit à petit sa palette musicale et son répertoire
d’émotions tout en restant un laboratoire annexe dans l’ombre d’Isis. Maintenant que ce dernier n’est plus, il y a fort à parier qu’Aaron Turner
pousse son projet sur le devant de la scène et s’il continue à sortir
des albums de cette trempe, on ne peut que lui en savoir gré. L'expérimentation glaciale et hypnotique, minérale et habitée d'House Of Low Culture ne demande qu'à être explorée, plongez-y sans tarder.
leoluce